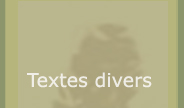|
On t’appelait Mathéo, mais ton
nom était Margossian…
On t’appelait Libobi (Baron Cigare), mais ton prénom
était Migirditch.
J’ai appris à t’apprécier
bien après t’avoir rencontré. Et, aussi,
un peu par hasard parce
que ma mère t’a aimé. N’était-ce
pas naturel ?
Tu étais indomptable, extravagant
(le mot n’est pas trop fort), original…
Personne ne pouvait raconter Stanleyville,
et se vanter de cette cité, et dire qu’il ne
t’avait pas rencontré.
Kisangani, ex- Stanleyville…
Un tailleur confectionnait tes chemises à
ta mesure, style marin, et les bracelets de tes montres y
étaient assortis, chaque matin. Tu achetais des caisses
de cigares aux Pères Blancs d’Afrique Noire,
à Kigali. Comme eau, tu ne buvais que du Périer,
acheté à je ne sais quel grossiste, et elles
étaient emmaillotées de paille et rangées
dans des caisses en bois, ce qui les rendait luxueuses, à
mes yeux. Tu n’avais qu’un seul parfum, le Soir
de Paris, contenu dans de merveilleuses bouteilles bleu outremer,
que mon enfance regardait avec émerveillement.
Tu avais consolidé ta fortune à
la sueur de ton front, et à la grandeur de ton intelligence.
Plantation de café à Yolo ;
immeuble de rapport «le Bloc de Paris »; transport
(3ème Transport) ; concession de voitures Fiat, et
de camions (Unimog) (combien de fois ai-je rêvé
devant tes camions !) ; boulangerie Le Vatel … t’appartenaient,
sans compter les ateliers, les merveilleux camions poubelles
que tu louais à la voierie, les ateliers mécaniques
et divers autres immeubles.
Tu avais des associés ou des amis
provenant de diverses communautés : pour la Grèce,
Polycarpou ; pour l’Italie, Zanetti ; pour l’Arménie,
Dervichian ; pour l’Angleterre, Duncan Smith ; pour
la Belgique, madame Simone… ; sans compter d’autres
aux consonances étrangères, dont je ne me souviens
plus…et qui n’ont fait que passer !
Tous ces amis tu les recevais avec faste
et simplicité, avec abondance et générosité.
Tous ceux qui passaient à Stanleyville étaient
les bienvenus, avant comme après le 30 juin 1960, ce
fatidique jour de l’Indépendance. Tous les samedis
soir c’était ton petit Byzance… Prosper,
le boy dressait sur la table du living « Rouge Fiat
» les plats simples de ta composition : poivrons rôtis
accompagnés d’aïoli, rizotto aux poireaux,
tarama que l’on servait à la louche sur des tranches
d’aubergines poêlées à l’huile,
et des tas d’olives de toutes les couleurs.
Je me souviens que tu m’avais raconté
ton enfance, mais je n’avais que dix ans alors !
Tu quittes ta maman en disant : « je
vais là ».
Et pour lui en indiquer le lieu, et prouver
son existence, tu fais tourner une mappemonde et tu pointes
l’index sur cette tache presque inconnue à l’époque.
Région tropicale et austère. Tu pars, arménien,
peut-être pour reconduire l’histoire de ton propre
père, qui a du fuit pendant l’exode, et a du
lui aussi fort souffrir pour être et devenir. Terra
Incognita entre le nord de l’Afrique et l’Afrique
du Sud, dans un bassin que Stanley et Livingstone avaient
dû arpenter avant toi. C’était le Congo
de Léopold II, prometteur à cette époque.
Tu y étais arrivé en bateau.
Tu avais commencé à gagner ton premier argent
en transformant des fûts d’essence de 200 litres
en malles pour voyageurs.
A dix ans tu étais mon Père
et mon Dieu à la fois, dépassant l’un
et l’autre par la force de ta personnalité. Tu
régissais mon univers par cette puissance que tu dégageais.
Tu m’as éduqué, transformé,
poli en quelque sorte, à un tel point qu’allaient
naître les prémices qui m’ont conduites
à ce que je suis devenu aujourd’hui, avec mes
qualités, mais aussi mes défauts. Réussir,
travailler…
Margossian, quelle force physique et morale
t’a amené à être celui que tu as
été. Un self made man, dur et sensible à
la fois, altruiste et généreux. Comment comprendre
la courbe étrange du destin que tu as parcourue ?
C’est pour te rendre hommage que j’écris
ces lignes.
En lisant Kessel, j’ai retrouvé
beaucoup de traits de ton caractère. N’étais-tu
pas cet Ouroz, qui veut gagner le Bouchkazi, pour émerveiller
son entourage, s’émerveiller lui-même,
et être fidèle à ses promesses d’enfant?
Pour témoigner de sa vaillance et brûler la chandelle
par les deux bouts.
Chaque lecteur de ces lignes t’imaginera
ou se souviendra de toi.
N’as-tu pas acheté aux enchères
tout un lot de camions dont tu détenais les pièces
vitales, par hasard…et le hasard faisait bien les choses…à
en rire aujourd’hui…il y a prescription ! N’as-tu
pas avec cette chance créé une compagnie de
transport, et puis une autre, et puis encore une autre…La
3ème Transport ? Mais ne peut-on parler que de la chance
? Derrière tout cela il y a du travail et de l’acharnement…
N’as-tu pas, avec une de tes Fiat,
remonté le perron du Stanley Hôtel par un soir
d’ivresse… ?
Ne m’as-tu pas demandé de revendre
quelques dizaines de milliers de bouteilles de Périer
au prix du verre pour financer l’achat de mon premier
vélo ? Il y en avait toute une benne de camion !
Ne m’as-tu pas donné de centaines
de pages de punition à écrire, que je devais
ensuite réciter, ligne par ligne, pendant que tu sirotais
ton whisky et fumait ton cigare ? Parce que j’avais
rencontré un ami au bord de la Tchopo, et n’avais
pas osé lui dire bonjour, tu m’avais donné
cent pages à écrire « bonjour mon cher
ami Alkin, comment vas-tu ? ». Albert Alkin, t’en
souviens-tu ? Cent pages sur du papier de récupération
d’une fusion avec Duncan Smith. Et chacune de ces pages,
je devais les ligner en faisant rouler une grosse règle
noire, sur le papier jauni et terni sur les bords.
N’ai-je pas dû apprendre pendant
deux ans l’accordéon parce que j’avais
seulement dit : « j’aimerais avoir un accordéon
». Combien de fois n’ai-je pas dû chanter…
« au bord des quais, jolie Copenhague, au bord des quais…
»
Force de la nature tu croyais en ce pays
qui s’était développé avec toi.
Y avait-il, pour toi, un ailleurs où vivre mieux ?
Et puis, c’est la sœur de ma mère
que tu as fini par épouser…elle était
plus jeune ! Et tu as eu deux enfants que tu as appelés
Tarzan et Samson. Et que tu as élevés à
la dure.
J’ai quitté Stanleyville un peu avant l’Indépendance,
et j’ai perdu ta trace. Mais on m’a raconté
que quand le pire est arrivé, tu t’es toujours
montré courageux. Ton associé a été
fusillé lâchement à tes côtés.
Tu as fait transporter dans tes « camions poubelles
» les Belges qui se sauvaient et qui voulaient, du centre
de la ville, rejoindre l’aéroport.
Tu as été « zaïrisé
», puis « dézaïrisé ».
Ta femme s’est installée en Italie, non pour
fuir le pays, mais pour pourvoir à l’éducation
de vos enfants.
Un jour, que j’étais à
l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers
pour soigner une bilharziose, je tombe sur toi; Personne ne
savait que tu étais en Belgique. Tu viens passer une
journée dans ma fermette près de Hannut.
Une amie te reconduit à Bruxelles
le samedi soir, et je lui ai demandé comment s’était
passé le « retour ». Amusée, elle
m’a dit : « il n’a pas dit grand-chose »,
sauf, en plein cœur du voyage, une seule phrase : «
tous des bougnoul » ! Et tu es resté là,
enfermé dans ton silence.
Combien tous ces événements
devaient-ils te peser ? Ces promesses inachevées !
Ces rêves brisés !
Bien souvent, j’ai pensé à
toi, Margossian, à ces années 55-60, à
ta mine caractéristique, à tes cheveux un peu
cendrés, et légèrement ondulés,
mais séparés par une raie bien tracée
juste au milieu du crâne.
J’ai souvent pensé à
l’homme que tu étais, dur envers les autres,
mais aussi envers toi-même.
J'aurais voulu mieux te connaître,
mieux te comprendre. Etre plus adulte pour te faire face.
Depuis un demi siècle je n’ai
cessé d’entendre ton nom carillonner dans mes
oreilles. On croise tans de gens dans la vie que l’on
ne rencontre pas vraiment !
Tu auras été un de ceux-là ! Tans de
gens dont on ne perçois que les défauts, sans
rien comprendre de leurs qualités.
© Christian de Bray |